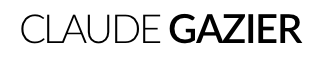Textes critiques
Gérard Mordillat, 2020
“Gremlins et Grumelats”Pour le peintre Claude Gazier, le monde n’existe pas. Il existe que dans l’obscurité propice d’une salle de cinéma, dans son intimité, ses secrets… A l’instar de Mia Farrow dans La Rose pourpre du Caire, qui n’a jamais rêvé d’entrer dans le film, de se mêler à l’action ? Qui n’a, un jour, souhaité donner la réplique aux acteurs, vivre de l’autre côté de l’écran ? Chacune des œuvres de Claude Gazier réalise cette vie rêvée. Des poussières d’étoiles tombées du faisceau d’un projecteur, il fait du cinéma en plan fixe, minéralise les stars, les décors, la lumière. Car c’est là tout le paradoxe de ce peintre qui, pour se payer une toile n’en utilise pas ! Ses peintures sont faites de grumelats de marbre, de sable et de béton travaillés à la chaux et l’encaustique. “J’ ai cherché une matière qui puisse traduire plastiquement le “grain” et la mobilité d’une image de film, révèle t’il, L’usage de matériaux de maçonnerie utilisés pour les fresques murales s’est imposé par leur présence physique, comme la matérialité des peintures de Balthus.” En son temps, Edward Hopper (1882-1967) s’est aussi nourri du cinéma, de ses cadrages, de ses lumières, de ses mises en scène. Comme dans le film de Francis Ford Coppola, une “conversation secrète” s’établit entre Gazier et Hopper. Toile par toile, plan par plan, ils se rejoignent, se défient, s’embrassent par l’image. Claude Gazier reprend la peinture là où Hopper l’a laissée. Plus exactement, il prend Hopper à son compte et le fait passer dans ses moelles. Gazier absorbe ce qu’Hopper doit au cinéma, ce que le cinéma doit à Hopper, ce que lui même doit au cinéma et à Hopper ; il l’irrigue de ses nerfs, de ses muscles et l’éblouit de couleurs avant de l’offrir au spectateur. Comme le dit Alice de l’autre côté du miroir : “On ne peut changer le passé, mais on peut en tirer des leçons”.
Le grain de la pellicule Aujourd’hui, l’immense majorité des films (pour ne pas dire l’unanimité) se tournent en numérique. La pellicule argentique qui était la matière première du cinéma n’a plus le droit d’écran. En perdant l’argentique, les cinéastes, réalisateurs et opérateurs ont perdu quelque chose de précieux : le grain de l’image. Un grain très différent selon les marques de pellicules. Le rendu de la Kodak n’était pas le même que celui de la Fuji. La pellicule Kodak avait la réputation d’être plus dure, la Fuji plus douce. Avant de commencer le film, le chef opérateur devait donc choisir quelle marque porterait le film, en serait la chair vive à l’écran. Choix artistique plus que technique ou commercial. Choix fondamental. C’est le grain de l’image, cette consistance particulière à la fois visible et invisible qui donnerait au film une profondeur, une sensibilité unique, une réalité aussi forte que la vie elle-même. Ce grain que Claude Gazier a fait sien ; un grain qui appelle la main autant que l’œil.
La peau des lettres Quiconque a tenu un parchemin (fait en peau de mouton) connaît la sensation extraordinaire de douceur, de finesse, de souplesse qu’il procure sous les doigts. On croit vraiment caresser la peau de l’écriture. En généralisant l’usage du papier, l’imprimerie a fait disparaître cette sensation. Aujourd’hui, on écrit froid sur une page blanche ou sur l’écran de l’ordinateur ; on filme froid sur du numérique en surveillant les oscilloscopes. Dans les deux cas, il y a une perte. Néanmoins avant d’écrire, tant qu’on peut prendre une feuille en main, la flairer, apprécier son grammage, son grain, la perte est moins grande pour la littérature que pour le cinéma. Pour le cinéma cette perte s’avère si vaste et si douloureusement ressentie par les cinéastes que des programmes électroniques ont été conçus afin de redonner du grain à l’image numérique ! Pour générer des images qui n’existent plus, le paradis perdu du cinéma.
Une cinémathèque de l’imaginaire S’il faut bien avoir en tête cette idée du “grain” de l’image pour apprécier le travail de Claude Gazier, il faut aussi avoir bien en tête l’idée de “l’impression” dans tous les sens du terme: empreinte et sensation. Claude Gazier affronte la grande mythologie contemporaine, celle du cinéma, de son âge d’or et de ses monstres sacrés. Son œuvre invente une cinémathèque de l’imaginaire dans laquelle il colore les plans à l’instar de Rimbaud colorant les voyelles. Brusquement, l’usage d’un bleu sur le visage de Simone Signoret dit, à lui seul, le tragique de l’image, la solitude de la femme qui nous regarde d’un au-delà du film ; la solitude de toutes les femmes, qu’elles soient vedettes de cinéma ou anonymes perdues dans un hall d’hôtel, dans le désert de leur vie. La peinture s’arrache alors à la tentation mortifère de l’illustration pour atteindre l’universel, l’expression critique, l’incarnation. Chacun de nous porte en lui une image inoubliable sortie d’un film. Une image qui nous a fait si forte impression que, dix fois, nous l’avons racontée à des amis jusqu’au jour où , revoyant le film, nous avons beau cligner des yeux, les écarquiller, nous ne la retrouvons pas. Elle n’existe que dans notre souvenir.
L’image fantôme Claude Gazier saisit cette impression unique, cette image fantôme qui nous a hantés et qui nous hante. Le peintre opère en archéologue du cinéma. Plus précisément un archéologue de la mémoire du cinéma. Pas de la mémoire des historiens, des dictionnaires et des anthologies, mais celle des individus, de vous et moi, dont il révèle soudain les images imprimées au plus secret de nous-mêmes. Images inventées de la mémoire, images rêvées, fantasmées… La peinture agit à l’égal du bain de révélateur pour la photographie. L’intime remonte à la surface des toiles de Claude Gazier avec un poids, une lumière, avec un grain ! Son œuvre n’est en rien la reproduction d’une photo de plateau, d’un photogramme ou d’une capture d’écran. Non, c’est une précipitation, une condensation cinématographique qui fixe en un geste unique ce que la caméra enregistre vingt-quatre fois par seconde. L’enjeu d’un livre se mesure, dit-on, sur un seul mot. L’immense Ulysse de Joyce s’achève sur un “oui” qui a donné des siècles de réflexion à ses lecteurs et à la critique. Les œuvres de Claude Gazier disent “oui” elles aussi. Oui, c’est de la peinture ; oui, c’est du cinéma ; oui c’est une image, “rien qu’une image”, comme disait Godard : Une image qui provoque notre regard sur un monde à travers une singulière camera obscura, un ensemble de tableaux dont nous n’avons pas fini d’explorer la profondeur. La peinture de Claude Gazier est une peinture de la fin des temps. Elle regarde notre présent comme au jour où il n’y aura plus sur Terre que la figure brûlée de bleu et d’ombre d’un homme vitrifié sur un mur, à Hiroshima.
Jean-Emmanuel Denave, 2017
Claude Gazier, « Paysages »
« Le vrai but de l'art n'est pas de créer de beaux objets : c'est une méthode de réflexion, un moyen d'appréhender l'univers et d'y trouver sa place ». (Paul Auster)
Étymologiquement, nous apprend le Littré, « appréhender » signifie saisir des mains, puis saisir de l'esprit, puis prévoir, et, par le passage de la prévision à la crainte, redouter... C'est en effet sur un certain fond d'angoisse, plus ou moins consciente, que nous appréhendons artistiquement le monde (par les sens, l'imagination, la raison) : angoisse qu'il ne soit radicalement autre que ce que nous projetons sur lui, angoisse que nos représentations ne se fissurent et laissent entrevoir alors son être intrinsèquement informe et insensé. En 1986, le peintre Gerhard Richter notait : « Mes paysages ne sont pas uniquement beaux, nostalgiques, romantiques ou classiques dans leur âme, tels des paradis perdus, ils sont surtout « trompeurs ». Par « trompeurs », j'entends dire que nous transfigurons la nature en la regardant, la nature qui, sous toutes ses formes, est constamment notre adversaire puisqu'elle ne connaît ni sens, ni clémence, ni pitié, parce qu'elle ignore tout, est totalement dépourvue d'esprit. Elle est notre absolu contraire, donc totalement inhumaine. »
Le chaos menace chaque peinture un peu sincère, et tout paysage est une tentative fragile d'y (re)trouver ou inventer un peu d'ordre et de perspective. Les Impressionnistes en savaient quelque chose, eux qui sont allés plus loin encore que le paysage classique, jusqu'à rendre les sensations changeantes de la lumière, les perceptions poudreuses et atomisées de l'air qui transportent, entre les objets et nous, des images... L'ordre du monde prenait avec les Impressionnistes une nouvelle « dimension » et une nouvelle fragilité, plus proche encore du « chaos » de la nature : celles des perceptions sensorielles et de leur mobilité évanescente.
Si nous faisons référence ici à Gerhard Richter et aux Impressionnistes, c'est parce que Claude Gazier les a beaucoup regardés (il a même revisité très directement deux paysages de Richter) dans ce nouveau tournant de son œuvre : le paysage.
Jusqu'à présent, le peintre se préoccupait surtout de scènes humaines tirées de photogrammes du cinéma. Dans le sillage d'un Edward Hopper, il aimait à représenter la mélancolie des films noirs, ou la tension psychologique palpable entre deux personnages, même si, en même temps, ses questions étaient aussi des questions de peinture : le clair-obscur, les contrastes colorés, l'invention de systèmes de tonalités...
Cette nouvelle étape, « Paysages », fait tomber les cloisons, disparaître ou s'éloigner les figures humaines, et s'ouvre aux road-movies : au Fil du temps d'un Wim Wenders, aux colères escarpées d'Aguirre et de Werner Herzog, ou encore à La Mort aux trousses de Hitchcock (qui pourrait constituer le film de transition entre le huis clos du thriller et le paysage angoissé fuyant son propre délitement). Pour ses paysages, Claude Gazier continue à travailler à partir de photogrammes de films, souvent en noir et blanc, dont il réinvente à sa guise les systèmes de couleurs. Là encore, une proximité avec Gerhard Richter mérite d'être soulignée : celle de s'inscrire parmi une variété (si ce n'est une variation) des régimes de l'image, comme autant de tentatives ou de manières d'appréhender les choses : par le cinéma, par la photographie, par la peinture, par l'imagination...
« La captation des nuances des vibrations de la lumière est le véritable sujet pictural de cette série. Pour cela j'utilise la transparence de la caséine en superposant des couches colorées sur la silice qui recouvre préalablement les tableaux : il s'agit pour moi de jouer de la contradiction entre l'affirmation de la matérialité granuleuse de la surface sablée et la recherche de l'illusion de la profondeur, tant atmosphérique que spatiale » indique Claude Gazier. Ses « paysages » condensent donc une double approche : perceptive et sensorielle. On peut y « voir » (perspective) et en même temps y « sentir » (matérialité) la nature, le tableau s'offrant à la fois comme « image » et comme « objet concret». En cherchant à exprimer le mieux possible l'atmosphère, les nébulosités, les différents degrés de la sensation, Claude Gazier nous « rapproche » du paysage, et, conséquemment, de son caractère intranquille et incertain.
Les nombreux chemins ou tracés (lignes blanches de passages d'avions, ponts, voies ferrées...) qu'il inclut dans ses tableaux indiquent d'ailleurs cette double lecture possible : une perspective assez « classique » et des « chemins » transversaux qui traversent autrement le tableau, pénètrent des nébulosités et des atmosphères colorées, entrent dans sa matérialité. Ces tracés sillonnant le tableau invitent le regard à une expérience, alternative ou concomitante à la seule contemplation distanciée. Ils invitent, comme le formule le philosophe François Jullien, à « vivre de paysage » : « Quand l'extérieur que j'ai sous les yeux sort de son indifférence et de sa neutralité : c'est d'un tel couplage que naît du « paysage ». Il y a paysage quand je ressens en même temps que je perçois ; ou disons que je perçois alors du dedans comme du dehors de moi-même – l'étanchéité qui me fait tenir en sujet indépendant s'estompe. »
L'appréhension du paysage par Claude Gazier (dans cet entre-deux pictural et atmosphérique qui nous relie à lui, et dans toutes les déclinaisons étymologiques du terme « appréhender ») tend à se traduire aussi par une affectation de soi, et par-là même, plus encore, à un changement de soi, à une modification du plus intime du sujet.
Gérard Mordillat, 2013
Pour Claude Gazier le monde n'existe pas. Plus exactement il n'existe que dans l'obscurité d'une salle de cinéma, dans son intimité, son secret…
A l'instar de Mia Farrow dans " La Rose pourpre du Caire " qui n'a rêvé d'entrer dans le film, de se mêler à l'action, de vivre de l'autre côté de l'écran ? Chacune des œuvres de Claude Gazier réalise ce rêve. Des poussières d'étoile qui tombent des écrans, il fait du cinéma en plan fixe, minéralise les acteurs, les décors, la lumière. Car, c'est là tout le paradoxe de ce peintre qui pour se payer une toile n'en utilise pas ! Ses peintures sont faites de granulats de marbre, de béton brossé travaillés à la chaux et à l'encaustique. Son œuvre n'est en rien la reproduction de photogrammes ou une capture d'écran, non, c'est une précipitation, une condensation de film qui, en un geste unique, fixe ce que la caméra enregistre vingt-quatre fois par seconde.
Il faut voir son travail comme un astre dans une galaxie où Edward Hopper transcende les cadrages du cinéma dans ses toiles ; où le cinéma se réapproprit Hopper, s'en empare pour s'en éblouir ; où Claude Gazier absorbe ce que le cinéma doit à Hopper, ce que Hopper offre au regard du spectateur, l'irrigue de ses nerfs, de ses muscles et le fait sien.
L'enjeu d'un livre se mesure, dit-on, sur un seul mot. L'immense Ulysse de Joyce s'achève sur un " oui " qui a donné des siècles de réflexion à ses lecteurs. Les œuvres de Claude Gazier disent " oui " elles aussi. Oui, c'est de la peinture, oui c'est du cinéma, oui c'est une image " rien qu'une image " comme disait Godard ; une image, des images, oui, qui provoquent notre regard sur le monde à travers une inattendue caméra obscura dont nous n'avons pas fini d'explorer la profondeur. Peut-être est-ce pour cela une peinture de la Fin des temps, lorsqu'il n'y aura plus sur terre que ces figures brûlées de bleu et l'ombre d'un homme vitrifié sur un mur à Hiroshima.
Pierre Souchaud, 2012
La peinture transfigurative de Claude Gazier
Les peintures de Claude Gazier sont des fenêtres ouvertes vers de délicieuses et infinies rêveries, et il est permis de s’interroger sur la nature de leur mystérieux pouvoir de fascination ou d’envoûtement. On pense alors que le sentiment ressenti est peut être de l’ordre de cette nostalgie que peuvent en effet déclencher ces visages de héros du cinéma de notre enfance ou ces « arrêts-sur-images » extraits de films anciens devenus aujourd’hui mythiques.
Mais l’on découvre bien vite que le mystère de ces peintures, leur vérité intérieure et ce qui nous touche - au fond -, se situe bien au-delà de cette sentiment lié au souvenir d’un passé heureux. L’on comprend qu’ici, le peintre procède à cette vraie mise en forme, qui permet de dépasser la représentation, la citation, l’anecdote narrative et la référence figurée. On assiste bien, dans la peinture de Claude Gazier ; à ce processus de transcendance du rapport à l’image empruntée au cinéma, de sublimation de l’émotion initiale, qui devient alors LE matériau de la peinture. Et cette mise à distance du sujet, devient le propos même de l’acte de création : une distanciation qui est celle de la mise en beauté ou de la mise en poésie, et qui paradoxalement est également appropriation et incarnation.
Cette incarnation de l’idée sensible est bien sûr matérialisation et mise en œuvre par une maîtrise des moyens techniques, et même par une invention de ces moyens comme on crée une nouvelle syntaxe et un nouveau vocabulaire pour maîtriser totalement le propos plastique et lui conférer sa plénitude expressive, sa totale indépendance et son ouverture. Et c’est ainsi que la sublimation de l’emprunt imagé, cette distanciation à la fois spirituelle et temporelle, se fait par un travail de proximité vraiment physique d’incrustation dans la matière même du support, ce granulat de marbre avec mélange de chaux conçu par l’artiste, qui donne à l’oeuvre la même intemporalité que celle de l’antique peinture a fresco. Et puis cette réappropriation mentale des images, se fait également par un très savant travail de recomposition et d’équilibrage architectural de la toile, qui va de pair avec la grande délicatesse de la mise en couleur.
Claude Gazier rêve les images de la vie réelle comme celles d’une fiction cinématographique , aussi, peut-on considérer ces dernières comme rampes d’envol pour une transfiguration existentielle qu’il accomplit par la peinture. Claude Gazier rejoint ainsi les David Hokney, Peter Voig et Edward Hopper, tous grands transfigurateurs de leur vie et du monde.
Robert Bonaccorsi, 2010
Non réconciliés
Hasard ? Prédestination ? Quoi qu’il en fût, Claude Gazier est bien né à Lyon, la ville des frères Lumière. Rien de plus naturel en somme pour un peintre qui célèbre avec constance et détermination le cinéma et ses mythologies. « Vous ne connaissez pas Lyon ? La preuve que c’est une ville épatante c’est que les peintres lyonnais ne quittent jamais Lyon »[1]. N’en déplaise à Henri Jeanson, Claude Gazier voyage. Il visite, explore, reconsidère le continent cinéma par et pour la peinture. Parcours périlleux, jalonné de chausse-trappes, de leurres, de carrefours trompeurs, de correspondances illusoires, d’affinités ambigües entre les deux modes d’expression artistique. Relations complexes qui se manifestent quelquefois de façon inattendue. La ou l’on attend Godard (ou Clouzot, Antonioni, Renoir, Pialat...) on découvre Jack Webb qui, dans Dragnet[2] (la police est sur les dents), 1954), filme le lieu (la scène) du crime tel un tableau impressionniste. Ici le cinéma s’inspire, se nourrit, procède, consciemment de la référence à la peinture. Tout ne serait donc qu’affaire d’influence(s), au niveau de la lumière, de l’accessoire, du décor. Une action réciproque qui s’exercerait sur les plans visuels, formels, narratifs, anecdotiques. Pour Claude Gazier le cinéma s’incarne dans des films qui constituent le sujet même de son propos pictural. Un cadre et un contexte, indissociablement. Il représente des films précis, identifiables et identifiés, significatifs, définis par leur puissance référentielle même. Un tramway nommé désir ( a Streetcar named Desire, Elia Kazan 1952), Le Rebelle (the Fontainhead, King Vidor 1949), I know where is man going (Michael Powell et Emeric Pressburger 1945), Le Guépard (Luchino Visceti, 1963), Le Tombeau hindou (Dans Indische Grabmal, Fritz lang 1959), North by Northwest (la Mort aux trousses, Alfred Hitchcock, 1952), Casque d’or (Jacques Becker, 1952), Et Dieu créa la femme (Roger Vadim, 1956), Mort à Venise (Visconti, 1971), Le Mépris (Jean Luc Godard, 1963), Le Paradis des mauvais garçons (Macao Joseph Von Sternberg, 1952), Les Portes de la nuit ( Marcel Carré, 1946), la Griffe de Passé (Out of the past, Jacques Tourneur, 1947), La Soif du Mal (Touch of Evil, Orson Welles, 1956), Le Mystère de la chambre jaune (Marcel L’Herbier, 1930)...
Tous relèvent d’un « âge d’or », notion incertaine qui conduit obligatoirement à l’évocation nostalgique du paradis perdu de la cinéphilie des « trente glorieuses ». Plus sûrement, ils participent à la délimitation d’un corpus, une cinémathéque idéale et personnelle, dont les éléments ont été choisis non seulement en fonction de leur charge fictionnelle et plastique, mais surtout de leur potentiel de rémanence. « Qu’est ce donc qui persiste ? ». Et Breton et Aragon de répondre en 1929 : « Ce qui trouve dans la vie en écho merveilleux »[3]. Le souvenir, la mémoire, certes, mais surtout l’image qui découvre sa validation en elle-même, qui possède et implique sa propre dynamique. L’image comme lieu commun, espace de connivence. La passion ne se confond pas pour autant avec un quelconque culte. Claude Gazier refuse la béatitude iconique au profit d’une subtile dialectique visuelle ou le déjà-vu s’apparente au « motif dans le tapis » d’Henry James. Installer la familiarité pour mieux instiller le mystère. Représenter le monde à partir de l’effet de réalité du cinéma qui, depuis 1895, développent des rapports incestueux avec la peinture. Une fascination mutuelle entre deux univers qui, s’interpellent, cohabitent, pour mieux se refuser, se concurrencer ou se retrouver fortuitement. Un enchâssement paradoxal, discontinu et conflictuel dont Claude Gazier rend compte dans son principe et ses variations. Pour ce faire il s’éloigne paradoxalement de tout projet strictement descriptif ou mimétique. Il joue avec la reconnaissance pour mieux s’en écarter.
Claude Gazier repense le plan, recompose la scène en l’insérant dans une continuité onirique. Soit Simone Signoret (2004), tableau réalisé à partir d’un plan de Macadam (Maral Blistène, 1946) qui se retrouve sous la forme d’une photographie insérée dans une séquence du film de Maurice Tourneur Impasse des deux anges (1948), cadrée en gros plan entre les doigts de Jacques Castelot. Une image donc qui se perpétue du film aux affiches, des photos de plateau aux magazines et qui s’accomplit dans l’archétype de la fille de mauvaise vie/femme fatale qui trouve son aboutissement dans Dédée d’Anvers (Yves Allegret, 1948)[4]. Une mise en abyme que Claude Gazier utilise pour décontextualiser l’image en affirmant sa présence muette. Les sources de Claude Gazier relèvent du cinéma parlant, du dialogue, des éclats de voix, du murmure, du bruit, de la musique, du son comme ellipse ou redondance. Pour autant ses tableaux intrinsèquement silencieux ne renvoient pas au mutisme éloquent des films des débuts du cinéma, mais à un arrêt sur image qui rompt la séquence narrative pour l’insérer dans la mémoire du regard, dans cette persistance du souvenir visuel, de l’émotion partagée dans l’obscurité des salles. Ici se dessine une quête des origines, de la révélation de la projection cinématographique, de cette découverte des apparences sur la toile. « Tout se passe dans un étrange silence. On n’entend pas les roues des voitures, ni le bruit des pas, ni les conversations. Rien. Pas une seule note de la complexe symphonie qui accompagne toujours le mouvement de la vie (...). Devant vous la vie surgit, une vie fixée de mots et coupée du spectre des couleurs de la vie (...) Ce n’est pas la vie, mais son ombre, ce n’est pas le mouvement, mais son spectre muet »[5]. Maxime Gorki traduit ainsi son malaise à l’issu d’une séance du cinématographe Lumière à Nijmi Novgorod en Juin 1896. « Ici commence le pays des fantômes. Et quand il eut dépassé le port, les fantômes vinrent à sa rencontre »[6].
Claude Gazier capte ainsi l’éternité du rêve cinématographique et la vitalité spectrale de ses incarnations. « Forever Young, la Diva », préciserait Jean-Jacques Lebel[7]. La couleur se trouve restituée non dans l’imitation des procédés (technicolor ou autres) mais comme le résultat d’une démarche originale, un travail sur le chromatisme qui se révèle comme matière pour mieux capter la lumière, le scintillement, le grain de l’écran sur la toile. Fernand Léger parlait de l’affiche de cinéma comme d’une « image en couleurs » qui « crève l’écran, rentre dans la vie de tous les jours, on ne l’oublie pas »[8]. Loin de tout effet d’annonce, Claude Gazier restitue à l’image-cinéma son poids, densité, son inscription concrète dans le temps et l’espace en créant sa propre échelle chromatique : pastel, bleu (une « nuit américaine » perpétuelle ?), ocre, clair-obscur...
Architecte de formation il utilise des matériaux de construction : fourche et gravies de marche, béton, sable, graines de quartz... pour s’approprier la lumière il colle, gratte, enduit de chaux ses supports (des panneaux d’isorel le plus souvent). Il se sert de la cire, de la caséine, du crépi, mais aussi de l’acrylique, du stucco... des techniques de décoration complexes, évolutives qui captent « l’obscure clarté » (les Couleurs du noir dit-il) propre au cinématographe[9]. Le travail de Claude Gazier se déploie à partir de la double quête de l’origine et de l’essence du cinéma qui n’existe que dans un rapport singulier à l’image. Ecoutons Jacques Aumont dans la perspective ouverte par Jean Louis Schefer : « Si l’Homme ordinaire du cinéma est un livre fondateur, c’est pour avoir dit cela : l’image du cinéma n’est pas une carte postale, un beau tableau, une scène théâtrale ni une projection fantasmatique, elle n’est pas d’abord le découpage que mon attention projette sur le monde ; au contraire elle est le site d’une promenade de poussière, le champ mystérieusement granulé d’un échange d’intensités- lumière et conscience, blanc-et-noir et terreur ou désir-qui sont comme des songes en ce que leur succession est inarrêtable, imprévisible, incalculable par moi qui n’y figure pas. Comme l’image de rêve, comme celle du souvenir, l’image de film a cette singularité profonde, que je ne m’y vois pas, que je n’y suis sous aucune espèce-même celle spéculaire qui asservit le tableau à un regard pyramidal (...).Lascaux est la première des théories de ce rêve- et théorie en acte. Ancrées ou enchâssées dans le grain de la pierre, faites de pigments proches encore de la terre à laquelle on les a volés, collées au subjectile par une alchimie si puissante que c’est comme une transformation de substance ou une traversée de la substantiation, les images y sont le défilé tranquille des phases, des écrans d’un rêve. Rêve de pierre, de carbone et de terres, plus nuageux s’il le faut que les nuages, flottant par devant ce support dont pourtant elles sont inarrachables[10]. »
Dans le même mouvement, Claude Gazier se réapproprie, en tant que peintre, la grammaire cinématographique : panoramiques, amorces, travellings, plans d’ensemble, plans rapprochés, contre-plongées... L’anamorphose, procédé qu’il utilise à plusieurs reprises (la Robe blanche de Marilyn, Irma la Douce, Baise-Main Hollywoodien, ...) et dont le principe même implique l’inscription du regard dans ses caractéristiques formelles et son mode opératoire, synthétise ce basculement. L’œuvre appelle un angle d’approche, un point de vue décentré, oblique qui seul peut restituer une perception cohérente, « logique », ordonnée. Une remise en perspective, ou le regard organise, confère le sens en s’objectivisant. La notion de cadre se découvre ainsi dans sa complexité et ses multiples fonctionnalités, au-delà de la simple délimitation matérielle, d’un système clos qui détermine la présence à l’image. La peinture de Claude Gazier s’affirme dans la tension entre l’évidence des rapports peinture/cinéma et la non-compatibilité des deux pratiques artistiques. Non Réconciliés[11], tel un couple en perpétuelle querelle. L’hommage (réel, évident, profond, au cinéma, n’existe paradoxalement que dans la confrontation. Le cinéma se décline ici pleinement aux yeux du souvenir. Il relève de ce plus grand partage culturel, de cette mémoire contemporaine sociale, idéologique, poétique, fragmentée, chaotique, faite de séquences, de scansions qui se déclinent de la toile aux écrans, de l’affiche aux photographies, dans un mouvement perpétuel ou les visions successives se basculent et contredisent. Le commerce, la culture médiatique, les mythologies modernes, l’histoire, la cinéphilie... en résumé une « usine aux images »[12]. « Pourquoi dit-on un "vieux" film et pas un "vieux" livre ? » s’interrogeait Jean-Luc Godard en 1995. Sans doute parce que seules les images recèlent une promesse d’éternité. Claude Gazier s’attache à cette historicité du souvenir, à sa présence corpscupulaire, à sa lumière. Aux images plus qu’aux films, à la suspension du temps plus qu’à la narration. A la matérialisation d’un rêve qui trouve sa source et son accomplissement dans un regard à jamais soumis à sa propre mémoire.
Jean-Luc Chalumeau, 2010
Claude Gazier - Un monde que nous n’aurons jamais fini d’explorer
Les fous de cinéma adorent la peinture de Claude Gazier : on les comprend. Mais les amateurs d’art aussi, quand bien même ils ne seraient pas tous férus de cinéma : c’est que ce peintre, malgré les apparences, ne parle pas que de cinéma. Il me semble que patiemment, obstinément, depuis 1985, il construit une esthétique originale à partir d’une autre esthétique et cela change tout : Claude Gazier a inventé un chemin original pour aborder le monde de l’objet esthétique, qu’il nous invite implicitement à suivre après lui. Essayons.
Tout artiste s’inspire du réel (il ne l’imite jamais) pour se mesurer à lui et le refaire. Or le réel de Claude Gazier est un réel au deuxième degré : celui des images du cinéma plus ou moins réalistes, plus ou moins oniriques, qu’il a choisies et combinées pour construire le monde particulier qui lui est propre.
S’il nous faut nommer ce monde, inutile d’additionner des titres (Gatsby le magnifique, Le Jardin des Finzi Contini, Le Mépris, Le Faucon maltais etc etc…) ; il s’agit du monde spécifique d’un auteur, un monde exprimé bien plus qu’il n’est représenté. Le monde de l’objet esthétique constitué par tout tableau de Gazier est un monde intérieur à cet objet, qui déborde à l’évidence la scène décrite, par exemple Bogart embrassant Bacall ou James Stewart guettant ses voisins de Fenêtre sur cour. Ces héros de cinéma étaient aux prises avec un certain monde ; le peintre qui les évoque est, quant à lui, aux prises avec un autre monde. Il est vrai cependant que les décors des films évoqués lui sont précieux. Certains plans ont été découpés comme des tableaux (il est des cas précis où le cinéaste s’est lui-même inspiré d’un tableau, ce qui fait que le « réel » de Claude Gazier n’est pas là au 2e degré mais au ne degré !). Cela dit, si le monde du peintre était simplement représenté, il ne se suffirait pas à lui-même, il serait indéterminé et incomplet : une nécessaire troisième dimension en serait absente, celle de l’expression. Chez Claude Gazier, un monde exprimé aimante le monde apparemment représenté.
Soit un grand triptyque : Gatsby le Magnifique ; du point de vue de l’artiste, une de ses œuvres les plus réussies (il a raison). Une œuvre véritable en tout cas, ce qui veut dire que même si elle déconcerte l’entendement (que fixent donc obstinément les regards des trois personnages masculins, relayés peut-être par le regard de la femme derrière eux, penchée au balcon ?), elle porte en elle le principe de son unité. Cette unité est à la fois l’unité perçue de l’apparence, ici rigoureusement composée (le point de fuite induit par les orthogonales du balcon et les ombres du mur coïncide sur le sol avec la direction des regards…) et surtout l’unité sentie d’un monde représenté par l’apparence, unité émanée de cette dernière en quelque sorte (au-delà du film de Jack Clayton, de l’univers romanesque de Francis Scott Fitzgerald, et encore au-delà, des figures devenues mythiques de Robert Redford et de Mia Farrow…) de telle sorte que le représenté signifie lui-même cette totalité et se convertit en monde. Le monde de Claude Gazier.
Oui, le nom du peintre doit être maintenant prononcé : l’auteur tel que l’œuvre le révèle est en effet le garant de ce que l’œuvre révèle. L’unité de l’atmosphère dans toute l’ œuvre féconde de Gazier, c’est véritablement l’unité d’une weltanschauung au sens d’une métaphysique vivante en l’homme : cette manière d’être au monde qui se révèle dans un comportement, en l’occurrence une façon absolument spécifique d’intégrer des images venues du cinéma qui n’a rien à voir avec on ne sait quel discours d’abonné de cinémathèque.
Le principe supérieur d’unité vient à l’objet esthétique selon Claude Gazier de ce qu’il est capable d’expression : il signifie non seulement en représentant, mais, à travers ce qu’il représente, en produisant sur moi qui le perçoit une certaine qualité d’impression que les mots ne sauraient traduire, mais qui se communique en éveillant un sentiment. Disons que cette qualité propre à Gatsby le Magnifique comme à toutes les autres peintures de Gazier est une « atmosphère de monde ».
Tous les éléments du monde représenté par Gazier, selon les modes de leur présentation qui sont particulièrement élaborés, même du point de vue strictement matériel (l’artiste travaille avec de la « cire et chaux sur granulat de marbre » ou bien du « béton moulé » ou encore de la « chaux et cire sur mortier » à moins que ce ne soit « sur sable », de manière à obtenir un grain, un velouté de l’image absolument original), conspirent à produire cette atmosphère de monde, elle-même inimitable.
Résumons-nous : chez Claude Gazier l’expression fonde l’unité d’un monde singulier. Il ne s’agit pas d’un espace percevable, ni d’une somme totalisable puisque je ne peux pas saisir cette unité du dehors. Elle procède d’une cohésion interne qui n’est elle-même justiciable que de la logique du sentiment : celui qui anime le peintre et l’inspire à partir de sa relation intime et constante au cinéma, son « objet petit a » aurait dit Roland Barthes. Je remarque que ce sentiment intègre, mais exclut aussi (jamais de scènes comiques ici). Le monde de l’objet esthétique constitué par l’ensemble des tableaux de Claude Gazier est ouvert, mais plutôt en « intension » qu’en extension, ou bien, si l’on préfère, en profondeur. Ce monde est une possibilité indéfinie d’ouverture à des objets liés, accordés à une qualité commune qui est tout simplement le goût de l’auteur pour un certain cinéma, et non pas n’importe quel cinéma. Les objets et les figures représentés par le peintre composent à l’évidence un monde, mais ils ne le composent qu’à la condition que l’expression apporte l’unité dans la multiplicité.
Le cinéma a lui aussi le pouvoir de convertir ainsi les objets qu’il représente, et c’est ce pouvoir de conversion que reprend, transforme, commente et sublime la peinture de Claude Gazier. Chez lui, le monde exprimé est comme l’âme du monde représenté qui serait son corps. La relation qui les unit les rend bel et bien inséparables, car c’est ensemble qu’ils constituent le monde de l’objet esthétique selon ce peintre étrange et inclassable à propos de qui tant de contresens apparaissent possibles. Mais c’est la rançon de la qualité particulière du « monde de l’œuvre » de Gazier : une totalité finie mais illimitée, qui est ce que l’œuvre nous dit à la fois par sa forme et par son contenu, sollicitant en nous aussi bien la réflexion que le sentiment. Si bien que nous n’aurons jamais fini d’explorer le monde de Claude Gazier.
Jean-Philippe Guye, novembre 2009
Claude Gazier. Un rêve en consistance
Platon, dans un texte fameux de la République, prétend que l’image réalisée par le peintre n’est jamais que le simulacre d’une imitation : le fruit d’une double dégradation. La chaise, le lit peints reproduisent, à perte, les images imparfaites d’un artefact – chaise ou lit du menuisier, eux-mêmes approximations de la forme, qui n’appartient qu’au dieu. Éloigné de trois degrés de la vérité, l’art est triplement menteur, ou, ce qui nous importerait davantage, triplement décevant : au regard de la vie comme à celui de l’idée que nous nous en faisons.
La vraie vie serait ailleurs que dans les salles obscures, les ateliers de peintre ou les salles de concert. « Voir le jour se lever est plus utile que d’entendre la Symphonie Pastorale » avançait encore Debussy…
Producteur d’images, mais aussi peintre d’après l’image, Claude Gazier fait le pari inverse : non de la dégradation iconique propre à toute imitation factuelle du réel, mais d’une double transvaluation. Procédant du cinéma le plus artefactal – son paradigme hollywoodien –, il en construit une image elle-même hautement factice. Et c'est pourtant là, dans l’irruption de cette lumière, de ce grain, de cette situation, que nous sommes saisis, non par un effet de re/production, mais par une essence survenue, un archétype dit Claude Gazier, dont le pouvoir de vérité ne décrit pas, mais produit un réel, à sa manière autonome, quoique entièrement gagé sur celui de son image-source.
L’artifice – le fait d’art – est au cœur de la démarche de Gazier. Sa peinture ne procède pas tant du cinéma que de son histoire : Lang, Hitchcock, Godard… ; c'est-à-dire pas tant d’un cinéma courant, au sens aléatoire de l’actualité, que de ses inscriptions dans nos mémoires. Non l’image mouvante et souvent ordinaire dont s’abreuvent les écrans, mais l’image arrêtée de sa trace en nous. Et pas davantage tel ou tel film que la peinture se proposerait d’illustrer (une œuvre de Gazier ne nécessite nullement qu’on connaisse le film évoqué), que la résonance de sa mythologie, une rêverie autour de sa trace. Claude Gazier ne peint pas la réalité comme les peintres de la “nature” (en l’occurrence humaine) ont pu le faire – un Manet ou même un Hopper, auxquels il fait parfois penser –, mais une nature déjà façonnée, fictionnée à travers l’histoire du cinéma.
D’où sans doute le choix de la photographie, ou de l’image arrêtée, dont l’artiste procède, et qui opère un second prélèvement sur le réel. Si le cinéma est en son essence même cinétique et temporel – écriture par l’image en mouvement (cinéma/to/graphe) –, la photo est une ponction opérée dans nos mémoires : un éclat partiel, sélectif, volontaire. Or, tandis que la photographie d’un film n’est que le signe renvoyant au film dans son déroulé, le travail qu’opère le peintre abstrait l’image de son référent narratif, l’essentialise pour en faire un objet stable et autonome.
Claude Gazier insiste sur sa fidélité aux images ; il ne veut, précise-t-il « s’approprier ni détourner l’image filmique mais [en] sonder la dynamique » (nov. 2009). Le cinéma contient “en puissance” (dynamis) ce dont la peinture se fait “l’acte” : le travail du peintre, le prolongement dans son imaginaire, puis dans le nôtre, de l’archétype. Et s’il est vrai que les images peintes sont de véridiques développements de leur source, de cet imaginaire déjà sédimenté dans l’image, elles en créent – plus qu’elle n’en montrent – l’envers : comme l’autre côté d’un miroir.
Cet acte du peintre s’opère en un triple procédé de transformation : le cadre, la couleur, la matière.
Cadre. Gazier part d’une image qu’il recadre, zoomant sur elle ou élargissant au contraire le champ autour d’elle. De nombreuses œuvres mettent ainsi à distance le sujet en l’isolant comme à travers le trou d’une serrure – renvoyant le spectateur à son statut de voyeur ; mais remplaçant la pénombre de la salle par le hors champ des visages tronqués, la temporalité du déroulement filmique par l’imagination du spectateur-voyeur. Il déplace, organise, recrée les perspectives dont il est maître ; et par elles tout un théâtre du regard. – Que l’on prenne garde, dans ce Gatsby le Magnifique, à la manière dont le point de fuite induit par les orthogonales du balcon et des ombres supérieures du mur, coïncide, sur le sol, avec la direction des regards des trois personnages, comme si ceux-ci fixaient obstinément le point nodal, autrement invisible, de la composition…
Matière. Gazier travaille, non la matière lisse de la toile ou la pleine pâte de l’huile, mais des matériaux denses, rugueux sur des surfaces dures : granulats de marbre agglomérés, ici fresque sur enduit maçonné, qui transposent là encore le réel, le sculptent, estompant les contours tout en projetant la lumière qu’ils réfléchissent et qui paraît émaner d’eux.
Couleur Gazier, enfin, ne colorise nullement les images noir et blanc, il les transmue par une couleur mentale – à la manière des Fauves ou des peintres de la Brücke : bleus sourds des visages, jaunes flagrants, orange péremptoires. Ou modifie, recrée les noir et blanc. S’approprie – ou si l’on veut interprète la couleur, comme un musicien impose son propre tempo, à l’intérieur même des contraintes métronomiques et de la stabilité de l’écriture.
Ce triple filtre apposé à la surdétermination de l’image filmique ouvre l’espace dans lequel la création du peintre se déploie. Espace contraint, comme pour toute véritable liberté créatrice. Espace formel : forme, matière, couleur. Espace mental, aux antipodes, comme le cinéma dont il procède, de toute forme de réalisme ou de naturalisme : non la captation d’une réalité, mais la construction délibérée d’une fiction, d’un rêve en consistance, élargissant l’imaginaire contemporain au cœur de ses mythologies.
Patrick Lemoine, 2008
Un drôle de cinoche par un drôle de gazier !
Que la cause soit entendue une fois pour toutes car je n’aurai de cesse de l’affirmer, le répéter, le proclamer même, cet homme est un faussaire ! Un abominable saltimbanque ! Un voleur de foules.
Et je le prouve !
Je considère Claude Gazier comme le plus grand parmi les maîtres de l’illusion. Un triomphateur du trompe-l’œil, un fou du faux-semblant.
Dire que cet homme est architecte et que tous ses bâtis sont sur châssis ! Que sa planche à dessin n’est rien d’autre qu’une palette irisée ! Metteur en scène de polars, ses pellicules sont gravées sur le marbre. Pour admirer sa putain en peinture, il oblige le visiteur consentant ou non à regarder en coulisse sur un écran oblique, transformant l’amateur en mateur. De gré ou de force, le public est le héros obligé d’étranges rush picturaux. Et comment résister à la folie créatrice de ce rapin du bâtiment, à ses pinceaux en truelle, ses huiles en mortier ? Comment ne pas dégringoler ses escaliers en travelling, ne pas fumer ses cibiches bogartiennes, ne pas guigner ses gambettes quand elles farandolent, éblouissants tourbillons anamorphiques ?
La faute à la robe de Marilyn ?
Stooop !
Vous pourriez quand même avoir pitié, Monsieur Claude, admettre que comme la plupart de vos ciné spectateurs, j’aie la tête qui tourne !
Laissez-nous un instant de répit, histoire de souffler en contemplant vos grands-parents… même s’ils ne sont que des ectoplasmes de stars.
Quelle famille !
Chaque fois que je suis confronté à une peinture de Claude Gazier, une question me taraude. Une interrogation m’obsède : pourquoi donc est-ce que j’aime cette peinture à ce point-là, alors que je n’aime plus tellement le cinéma ? J’ai honte de l’avouer, mais cela fait au moins dix ans que je n’ai pas mis les yeux dans une salle obscure.
Serait-ce la robe de Marilyn ?
À force de me creuser les méninges, je crois que j’ai fini par trouver.
Le chef est d’œuvre et l’œuvre est d’art, s’ils font rêver et moi, ce qui me fait rêver, c’est ce qui me ramène à mon panthéon personnel. Aux dieux toujours vivants de mon enfance, ceux qui ont veillé sur mes jeunes années, les ont enchantées comme tant de mes contemporains : Marilyn-Vénus, Humphrey-Vulcain, James-Cupidon, Burt-Jupiter, Grace-Diane, Rita-Junon, Gary-Apollon et tant d’autres précieusement conservés dans le tartare de ma mémoire. Simone-Minerve n’a pas quitté le casque d’or de mes fantasmes et Marlène est à jamais divine. Tous n’attendaient qu’un signe pour ressurgir sur la toile de ma conscience.
Et la robe de Marilyn ?
Parce qu’après tout, il existe des tonnes d’affiches, des monceaux de photos, des alignements de catalogues et aucun ne déclenche chez moi cet effet, aucun ne me procure ce type particulier d’émotion, ne me jette hors de moi comme un gazier. Je crois que le truc de ce peintre, son trait de génie, c’est d’être capable de ré animer mes héros. Regardez les cabotiner dans les allées de nos neurones. Les prunelles scintillent, les fumées dessinent d’étranges volutes, les cartes claquent sur la table, les moteurs des cadillac vrombissent et la robe de Marilyn...
Et moi, le Lyonnais, le commensal des frères Lumière, me voici réduit au rôle pitoyable de l’arroseur arrosé. Les larmes de Paulette Godard éclaboussent le plastron de mes certitudes. Les cendres de mes théories se consument dans le cendrier de ses tripots.
Je croyais dans ma rationalité de psy cartésien échapper aux sortilèges d’une anamorphose déjantée.
Je me pensais plus fort que la blanche robe de Marilyn.
Jean-Luc Chalumeau, octobre 2004.
La leçon de Claude Gazier
Claude Gazier peint des scènes de cinéma : des plans qui représentent presque toujours des couples. Les acteurs qui les incarnent étaient et demeurent célébrés (en leur temps, c’étaient des stars, aujourd’hui, ce sont des mythes). Il s'agit donc nécessairement d’un cinéma devenu ancien : celui des grandes heures de Bogart et Bacall, par exemple, et ce ne peut être le cinéma d’aujourd’hui. Ce qui intéresse l’artiste est ce qui habite sa mémoire, comme sans doute la nôtre aussi.
Claude Gazier assure qu’il ne s’agit nullement pour lui d’exprimer une nostalgie, mais plutôt de rendre présents des souvenirs. Que peut-on faire quand on est peintre et que l’on aime passionnément un certain type de cinéma maintenant disparu ? Claude Gazier commence quant à lui par recouvrir les visages d’un bleu intense : la réalité est ainsi suffisamment déréalisée pour qu’elle apparaisse étrange : une distance est établie. Le problème n’est pas de nous dire : ”voici Marlène”, mais bien : ”voici mon premier souvenir de Marlène”, ce qui n’est évidemment pas la même chose. Cependant, ayant établi une distance (par rapport au sujet), le peintre a créé dans le même temps une très forte proximité (par rapport a la peinture cette fois-ci). Il a en effet choisi de travailler un matériau très particulier, fait de fragments de marbre agglomérés, qui donne un poids, un effet de présence exceptionnel au tableau. Son projet est aussi éloigné que possible de la recherche d’une imitation du rectangle lumineux de l’écran voici au contraire des objets lourds : la profondeur, dans ces tableaux, n’a rien de cinématographique, elle est essentiellement picturale.
De telle sorte que ces stars s’imposent à nous par effet de présence curieusement ambigu, puisque fait de distance et de proximité a la fois. Il me semble que toute l'œuvre de Claude Gazier résonne comme un cri d’amour a l’authentique cinéma de sa jeunesse - disons le cinéma du temps ou n’existait que si peu la télévision - et comme une dénonciation implicite, mais ô combien éloquente, de la vacuité du cinéma fabriqué actuellement pour (et part) la télévision. Claude Gazier me semble reprendre, a vingt ans de distance et avec ses propres moyens, le combat mené par Fellini avec son admirable Ginger et Fred contre ce qui se tramait alors.
C’était le temps ou le cinéma italien sombrait corps et biens, déjà berlusconisé par un entrepreneur expert en décervelage du peuple, prédécesseur du patron d’une grande chaîne de télévision française déclarant tout récemment s’employer à ce que son public soit disponible pour accueillir les messages de Coca-Cola. Claude Gazier ne crée pas de pamphlet, il démontre simplement que la peintre a toujours le pouvoir de traduire sans discours toute chose concernant l’homme. Le langage artistique, chez lui, provoque de la présence avant de susciter du sens : c’est la leçon que je tire de la célébration d’un certain cinéma disparu par Claude Gazier aujourd’hui.